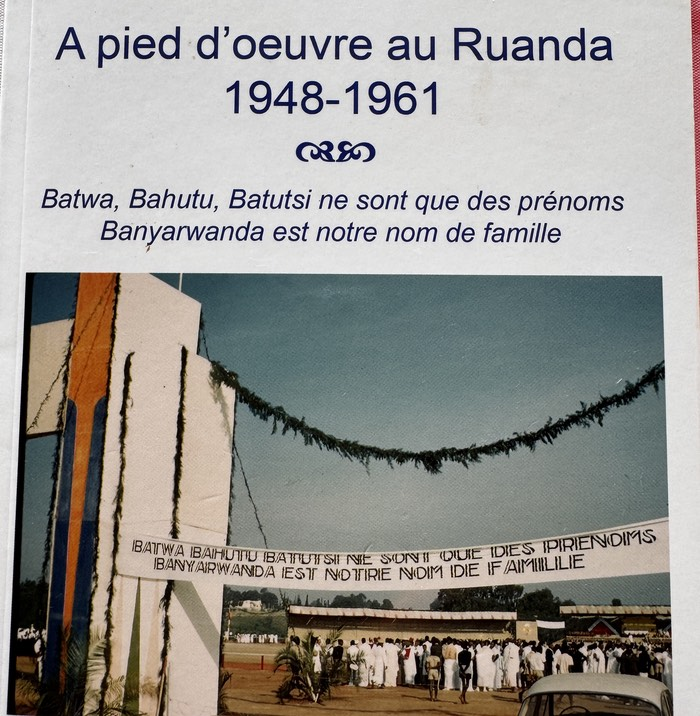
By Alain Destexhe*
Alors que les relations entre le Rwanda et la Belgique sont au plus bas, un ami m’a prêté “À pied d’œuvre au Ruanda, 1948–1961” de Julien Nyssens, publié en 2012 aux éditions Source du Nil. Ce livre est un témoignage unique sur la mentalité et les représentations des administrateurs belges à la fin de l’époque coloniale.
L’auteur, administrateur territorial, fut un témoin privilégié des changements politiques voulus par la Belgique dans les dernières années de la colonisation. Parmi les anecdotes qu’il rapporte, l’une illustre bien le bon état des infrastructures de l’époque : il parvient à récupérer sa petite Volkswagen au port de Matadi, au Congo, et à l’amener à Kigali via Bujumbura en une semaine, un trajet aujourd’hui impossible, même en 4×4 !
Mais ce qui frappe surtout à la lecture de cet ouvrage, c’est que l’auteur, bien qu’écrivant en 2012, adhère encore pleinement aux concepts belges de l’époque vis-à-vis du Rwanda : « la féodalité », « le chemin vers la démocratie », « la révolution sociale », des concepts faussement calqués sur l’histoire européenne.
« Féodalité » décrit de façon caricaturale le système complexe de relations sociales entre Hutus et Tutsis. « Démocratie » fait référence à l’imposition brutale de la majorité hutue, jusque-là écartée du pouvoir traditionnel, sous l’impulsion des autorités belges. « Révolution sociale » désigne le changement radical de régime voulu par la Belgique et qui relève de l’ingénierie politique et sociale.
Ce brusque revirement de politique entre 1957 et 1961, qui n’avait rien de social ni de politique, est bien mis en évidence par l’auteur.
Comme il l’explique lui-même (page 64) :
« Parmi les causes internes qui ont bouleversé la société rwandaise entre 1957 et 1962, j’en retiens principalement quatre », à commencer par le revirement de la tutelle. « Jusqu’alors, la tutelle avait soutenu le système coutumier féodal, instaurant de la sorte une double colonisation. (…) La volonté d’affranchissement des cultivateurs (Hutus) a rapidement trouvé dans la tutelle et dans l’Église un soutien nouveau très engagé. »
L’auteur met particulièrement en lumière le rôle – néfaste – joué par le colonel Logiest. Le 4 décembre 1959, le résident civil André Preud’homme, jugé trop proche des autorités coutumières traditionnelles, est démis de ses fonctions et remplacé par le colonel Guy Logiest, déjà chef militaire, « à la grande satisfaction de l’immense majorité de la population ».
Logiest était « dégagé de tout lien avec les structures traditionnelles et leurs élites » et portait « un regard nouveau sur la situation troublée, en vue d’élections démocratiques. C’est donc la loi du plus grand nombre qui sera déterminante, le petit peuple représenté par le parti Parmehutu. Le choix de Logiest était donc clair : « il fallait tenir compte des revendications des leaders de ce parti. » Un parti purement hutu, créé dans une optique délibérément hostile aux Tutsis.
Un passage du livre illustre de manière saisissante cette réalité :
À quelques dizaines de kilomètres de Kigali, Julien Nyssens croise une centaine de Hutus armés se dirigeant vers Rwamagana. Il leur demande ce qu’ils vont faire. Ils répondent qu’ils vont « accomplir leur travail » – expression qui signifie mettre le feu aux maisons des familles tutsies vivant le long de la route. Lorsqu’il leur demande qui leur a donné cet ordre, ils citent le nom de son propre assistant belge. Indigné, il leur rappelle que c’est lui qui est chef et leur ordonne de rentrer chez eux. Ils obéissent, sachant qu’ils sont les plus nombreux et n’ont rien à craindre.
Troublé par cet incident, il se rend immédiatement à Kigali pour en informer le colonel Logiest :
« Mais quelle ne fut pas ma surprise de l’entendre dire qu’il était au courant de cette opération, que mon adjoint était venu le voir pour l’entretenir de son projet, qu’il l’avait autorisé à agir de la sorte et qu’il le couvrait. »
L’échange qui suit est révélateur :
– « Colonel, lui dis-je, alors il convient que vous choisissiez : ou bien ce sera moi que vous suivrez, ou bien ce sera lui. »
– « Monsieur Nyssens, répondit-il, il faut que nous gagnions les élections. »
– « Colonel, cela, je peux vous le garantir, mais nous pouvons y arriver sans effusion de sang. »
L’entente fut conclue : l’adjoint fut muté à Bujumbura.
Ce passage montre clairement le parti pris de Logiest et son objectif assumé : assurer la victoire électorale d’une majorité ethnique en favorisant la domination du Parmehutu. Il illustre aussi l’absence totale de considération pour le sort tragique réservé aux Tutsis, forcés de fuir en masse vers les pays voisins.
L’auteur ajoute cette réflexion troublante :
« Aujourd’hui, 50 ans après ces événements, je me demande si le colonel Logiest n’aurait pas pu négocier avec Kayibanda le cadeau qu’il lui faisait en soutenant aussi énergiquement sa politique de remplacement des cadres (sic). Car cette accalmie que j’ai pu obtenir à petite échelle, le chef des insurgés aurait pu l’obtenir à plus grande échelle, je veux dire sur l’ensemble du Rwanda. N’était-il pas possible d’obtenir de ces révolutionnaires (sic) qu’ils acceptent un compromis ? On aurait de la sorte limité la formation d’une diaspora. »
Ce passage est extrêmement révélateur de la politique menée par les autorités coloniales belges et l’Église à l’époque. La conséquence ? Pour les Tutsis, un exil de plus de 30 ans dans les pays voisins ou, pour ceux qui sont restés, une politique de discrimination systématique qui s’est poursuivie pour aboutir au génocide de 1994.
Pour les Hutus, cette période marque le début d’une instrumentalisation de l’histoire par leurs leaders et présidents successifs, construisant le récit d’un peuple opprimé par une minorité définie uniquement selon des critères ethniques. C’est précisément cette vision biaisée que le nouveau pouvoir, issu de la victoire militaire du FPR, a cherché à déconstruire.
Mais comment les autorités rwandaises pourraient-elles ignorer cette histoire en tentant de la transmettre aux générations futures ? Et surtout, comment est-il encore possible d’écrire, en 2012, après le génocide de 1994, des phrases telles que :
« Si, avec l’appui de la tutelle, les Rwandais ont pu se défaire des inégalités inhérentes à la féodalité et inverser, mais non supprimer, les déséquilibres dans leur société, s’ils ont pu accéder du même coup à la démocratie et obtenir leur indépendance politique, il n’en reste pas moins que la paix dans les cœurs et dans les esprits est encore à consolider. »
« Féodalité », « démocratie » ? Franchement, après tout ce qui s’est passé, comment peut-on encore tenir un tel discours ?
Je ne suis en général ni un adepte de la repentance ni de la culture de l’excuse, mais il est accablant de constater que la Belgique a joué un rôle aussi désastreux dans l’histoire du Rwanda. Je ne vois pas d’autre exemple en Afrique où le pouvoir colonial a tenté à ce point d’influencer la transition vers l’indépendance.
En écrivant en 2011-2012, Julien Nyssens ne semble toujours pas se rendre compte qu’il a lui-même contribué à façonner un système politique et idéologique dont les conséquences ont été tragiques. (Fin).
*Alain DESTEXHE, Sénateur honoraire belge, Ancien secrétaire général de Médecins sans frontières (MSF) international, Initiateur en 1997 de la Commission d’enquête du Sénat belge sur le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994.
