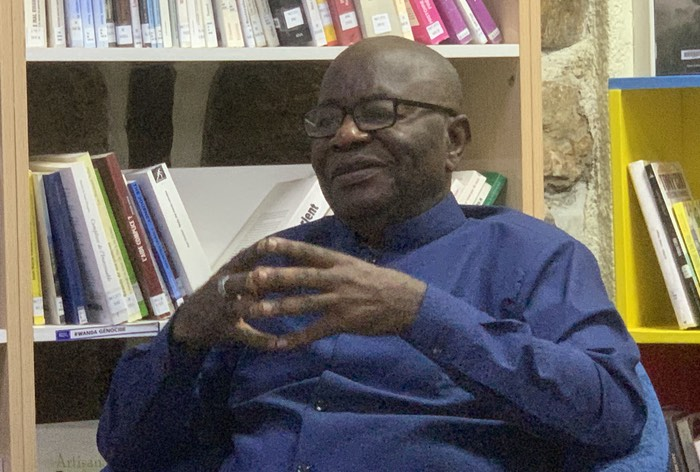
Basile Diatezwa au Centre Culturel Français de Kigali répond aux questions des participants à réunion
Basile Diatezwa (BD) est écrivain et un politicien de la RDC qui a participé activement aux Rencontres du Livre Francophone de Mars 2025 à Kigali. Il est sur le point de sortir un livre intitulé « La Problématique des Banyarwanda Congolais » dans lequel il montre les causes à l’origine de l’actuelle crise qui déchire la RDC depuis des années. Il montre une issue de sortie à travers ce qu’il appelle le « Pacte Citoyen ». Diatezwa ne doit pas être une voix qui crie dans le désert. Il mérite d’être écouté par tous. Interview réalisée par André Gakwaya de l’Agence Rwandaise d’Information (ARI).

Avec Manzi Rugirangoga, modérateur dans un panel.
ARI- Basile Diatezwa : Il est professeur, docteur, qu’est-ce qu’il fait dans la vie ? Il est écrivain, il est politicien. Brièvement, qui est-il ?
BD – Je suis un homme politique. Je fais aussi des publications, donc on peut dire que je suis aussi un écrivain. Pas dans le sens littéraire, disons, mais ici je fais des publications, des réflexions personnelles sur différentes problématiques sociopolitiques de l’Afrique et plus particulièrement de la région des Grands Lacs.
ARI- Mais avant vous avez été professeur, vous avez un doctorat universitaire ou bien ?
BD – J’ai deux masters. J’ai fait l’Université d’Anvers après mes études de sciences économiques à l’Université de Yaoundé. Bon, je me suis inscrit pour une thèse de doctorat à Nanterre, à Paris, mais mes activités politiques ont fait que je n’ai pas eu le temps de soutenir ma thèse et puis il fallait une subvention de recherche et ainsi de suite.
ARI- Mais vous avez été un chercheur, vous avez publié ?
BD- Pour le moment, le bouquin le plus important qui sera publié d’ici deux mois, c’est sur la problématique Banyarwanda au Congo. Les autres sont des réflexions d’une vingtaine de pages dans des revues scientifiques ou des articles dans des revues politiques ainsi de suite.

Avec JMV Rurangwa, écrivain, avant le panel
ARI- Revenons sur cet ouvrage qui sort bientôt, qui est d’actualité, qui parle de, la problématique de Banyarwanda en RDC.
BD – Donc, vous savez qu’au Congo, il y a une population congolaise d’expression Kinyarwanda. Et le mot Banyarwanda a été utilisé par le pouvoir colonial belge pour identifier des populations autochtones d’expression Kinyarwanda. En Ouganda, par exemple, vous avez aussi des populations ougandaises d’expression Kinyarwanda. Mais ils ont le label, par exemple, de Bafumbira. Donc, le mot Banyarwanda est utilisé au Congo, ça a été initié par les Belges.
ARI – Alors, les grandes lignes de cet ouvrage ?
BD – Les grandes lignes, ça dit que j’ai voulu d’abord comprendre ces violences ou ces dérives identitaires qui ont commencé à l’Est de notre pays, donc dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et pour comprendre ces violences, ces phénomènes sociopolitiques, il a fallu que je fasse des recherches personnelles sur l’histoire et l’anthropologie de la région des Grands Lacs. Et puis, j’ai été étudiant, j’ai fait justement mes études de troisième cycle à l’Université d’Anvers, connue comme étant un centre de recherche des Grands Lacs. J’ai eu comme professeur le Filip Reyntjens, qui est connu dans les publications scientifiques sur la région des Grands Lacs, par exemple. Mais en tant qu’homme politique, je me suis intéressé surtout à cette problématique de l’Est de la RDC pour comprendre ces violences identitaires.
ARI – Alors, est-ce que vous pensez avoir compris l’origine de ces violences ?
BD – Bien sûr.
ARI – Est-ce que c’est problématique ce qu’il y a à l’origine ? Et la voie de solution qui vous semble la meilleure ?
BD – Oui, bien sûr. C’est qu’il y a ce qui est en cours actuellement ? Vous savez, la cause principale des violences identitaires à l’Est, plus particulièrement la haine anti-Tutsi, qui a amené aux différents drames que nous connaissons dans notre pays, c’est qu’à un certain moment du processus postcolonial, on a dénié la nationalité, donc l’identité nationale de la communauté Banyarwanda, dont des populations, disons d’expression Kinyarwanda, des populations congolaises d’expression Kinyarwanda. Donc, la cause principale, c’est ça.
Vous savez, pendant la période coloniale, je fais une petite rétrospective historique. Je parle par exemple, après la Première Guerre mondiale, la Belgique a eu le tutorat du Rwanda et du Burundi, qui étaient des colonies allemandes. Mais l’Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale. Et le pouvoir colonial a fait de ces trois pays, donc Congo-Belge, Rwanda-Burundi, un seul espace administratif, politique. Il y avait un seul ministre des colonies, il y avait un seul gouverneur, et puis dans chacun de ces trois pays, il y avait des vice-gouverneurs. Donc pour le Belge, les populations de ces trois pays n’étaient que des simples sujets belges, aux mêmes pieds d’égalité.
Donc le pouvoir colonial a fait de ces trois pays un seul espace administratif, sécuritaire, sociopolitique, tout ça. Les populations de ces trois pays, vis-à-vis du pouvoir colonial, n’étaient que de simples sujets belges, sans droits politiques, au regard du pouvoir colonial. Et il y avait d’ailleurs des mutations régulières, par exemple des fonctionnaires qui partaient de Kinshasa, qui pouvaient aller travailler à Bujumbura, ou ceux qui quittaient Usumbura (Bujumbura) pouvaient aller travailler à Kigali. Bref, c’était le seul espace, un seul espace de la Belgique coloniale.
Dans cet espace, à un certain moment, il a fallu exploiter, par exemple, les richesses, disons, l’économie du Congo belge, un grand territoire qui était sous-peuplé. La Belgique ou le pouvoir colonial va chercher des travailleurs au Rwanda et au Burundi pour venir travailler dans les plantations à l’Est jusqu’au Katanga. Donc, ces transplantés, comme on dit, parce qu’il y a des Banyarwandas, c’est-à-dire que des Congolais d’expression Kinyarwanda, Congolais de souche, au Sud et au Nord qui vont partir. En 1910, quand on a fixé définitivement les frontières coloniales, il y a des Congolais d’expression Kinyarwanda qui sont, comme on dit, Congolais de souche.
Bon, les transplantés commencent à arriver après la première guerre mondiale quand le pouvoir colonial va commencer à exploiter l’Est jusqu’au Katanga. On a eu besoin de cette main-d’œuvre des populations venant du Rwanda et du Burundi. Et ça, c’est ce qu’on appelle les transplantés. Ce système de transplantés va s’achever jusqu’au début des années 50.
Maintenant, le troisième groupe qu’il faut prendre en considération, ce sont les réfugiés de 1959, particulièrement des Tutsis qui ont fui le Rwanda pour venir se réfugier dans les pays limitrophes du Rwanda. Et quand nous entrons à la période postcoloniale, donc le 30 Juin 1960, nous avons ces trois groupes d’expression Kinyarwanda.
Donc, les Banyarwanda, Congolais de souche, les transplantés, donc on peut dire Banyarwanda, et les réfugiés Tutsis de 1959. Notons qu’avant l’indépendance, donc avant qu’on proclame l’indépendance, le pouvoir colonial avait concédé aux transplantés d’origine rwandaise et burundaise des droits politiques, parce qu’ils ont participé aux élections communales, les transplantés. Et même ce problème des transplantés a été résolu à la Table Ronde de Bruxelles, qui préparait l’indépendance du Congo belge.
Et tous les acteurs politiques se sont mis d’accord que les transplantés du Rwanda et du Burundi, qui se trouveraient le 30 Juin 1960 sur le territoire congolais, ont de fait le droit des Congolais. Donc ce problème était déjà résolu, le problème des transplantés. Mais voilà que le sujet congolais, qui était un sujet belge, qui n’avait pas des droits politiques pendant la période coloniale, à partir du 30 Juin, il devient un sujet politique, il découvre le démon du pouvoir.

Dans un panel avec d’autres écrivains: Dorcy Rugamba, Maria Malagardis, Manzi Rugirangoga, et JMV Rurangwa
Et quand il découvre le démon du pouvoir, il est prêt à tout pour ses intérêts politiques, locaux, et ainsi de suite. Donc, on va connaître justement cette dérive. Par exemple, au Nord Kivu, s’il y a un candidat autochtone comme un Hundé, quand il est en face d’un concurrent Munyarwanda, donc rwandophone, il va dire que celui-là vient du Rwanda.
C’est là que les conflits vont commencer. Au niveau local, les conflits ont commencé parce que l’autochtone congolais va découvrir le démon du pouvoir, et pour lui, tous les coups étaient permis. Quand il y avait un adversaire qui était rwandophone, la seule stratégie qu’il avait, c’est de stigmatiser son origine du Rwanda ou du Burundi. Voilà le problème qui a commencé.
Et il y a une chose qu’il ne faut pas oublier. Quand le Katanga a fait sa sécession, et quand le Kassaï a fait sa sécession, des acteurs politiques du Nord Kivu, des Nandé particulièrement, comme le cas par exemple de Denis Paluku, qui était un des leaders nandé, voulaient l’autonomie du Nord Kivu. A l’exemple, des Kasaïens ou des Katangais. Mais ce sont les Banyarwanda du Nord Kivu, avec des leaders comme Rwakabuba, qui ont refusé cette sécession, qui ont dit que nous, nous restons dans la famille, dans la nation congolaise. Donc vous voyez déjà, dès le départ, il y avait des conflits au niveau local.
Malheureusement, ces conflits locaux vont déboucher à des massacres contre les Banyarwanda, particulièrement les Tutsis. Nous allons connaître la révolte des Kanyarwanda au début des années 1960, donc sous 62-63, il y a eu cette révolte des Kanyarwanda. Mais tous les gouvernements successifs depuis l’indépendance n’ont jamais apporté des solutions idoines pour résoudre ces problèmes identitaires au niveau local.
Et tous ces conflits locaux, tous ces antagonismes locaux, qui partent du Nord Kivu, du Sud Kivu, vont maintenant arriver à Kinshasa. Puisque des acteurs politiques régionaux, quand ils ont des ambitions au niveau national, ils vont évidemment, chaque fois, stigmatiser ce problème du Rwandophone pour dire que non, celui-là, il est venu du Rwanda, et ainsi de suite.
Évidemment, on va connaître l’apothéose de ces conflits qui ont commencé avec la loi de 1981, quand on commençait à inventer le concept de la nationalité douteuse pour les Congolais d’expression Kinyarwanda, et surtout qu’un Zaïrois qui était réfugié de 59, le Feu Bisengimana Rwema, était devenu directeur de cabinet du président Mobutu. Ça a encore aggravé des jalousies, des contradictions. Bref, dans mon livre, j’explique tout ça, pour que les gens comprennent le fond de ces conflits et que pour qu’on arrive à trouver des solutions idoines, la moindre des choses, c’est de comprendre ce phénomène de violence identitaire. Voilà le but de mon ouvrage.
ARI – Maintenant, la violence a atteint son paroxysme, avec le cannibalisme, la haine a atteint son paroxysme. Même le M23 est venu et a pris les armes pour contrer cette idéologie de la haine et l’idéologie du cannibalisme. Quelle est la solution que vous entrevoyez et qu’il faut imposer ?
BD – La solution aujourd’hui… Évidemment, pour apporter une solution, il faut identifier la cause principale. La cause principale, c’est le déni de l’identité de l’autre. Vous déniez à un Tutsi l’identité congolaise, vous déniez à un Hutu l’identité congolaise. Donc, nous devons résoudre le problème à ce niveau-là.
Et c’est ainsi que j’ai proposé le Pacte Citoyen, d’abord. Parce que, quelles que soient les réformes institutionnelles qu’on peut, disons, projeter, il faut d’abord que les Congolais s’acceptent mutuellement. Parce que nous sommes Congolais pour avoir été des simples sujets léopoldiens et belges.
On ne nous a jamais demandé notre volonté pour avoir la citoyenneté congolaise. Donc, nous sommes Congolais pour avoir été des simples sujets coloniaux. Et plus de 64 ans après l’indépendance, nous sommes encore au stade d’accepter l’autre pour un destin commun.
C’est ainsi que moi je dis, il faut d’abord qu’on se donne ce Pacte Citoyen à travers une concertation nationale. On a raté le coche à la conférence nationale souveraine. Et d’ailleurs la conférence nationale souveraine a échoué, suite surtout à ce qu’ils ont fait contre les Tutsi.
Rappelez-vous qu’à la conférence nationale souveraine, on a chassé tous les Tutsi qui étaient dans ces assises. Des personnalités comme feu Rwakabuba, un des pères de l’indépendance. Une personnalité comme le Mgr Kanyamacumbi, qui était le Secrétaire Général du Conseil épiscopal du Zaïre. Il n’a même pas été protégé par le Cardinal Mosengo qui présidait les assises de la conférence nationale. On les a chassés comme des chiens. Et d’ailleurs l’échec de la conférence nationale, qui disons, c’était l’apothéose de notre médiocrité politique, c’est ce qui a fait qu’on a connu le phénomène AFDL et le phénomène Kabila.
Parce que si on avait réussi tous ces problèmes à la conférence nationale, on n’allait pas connaître le phénomène AFDL, le phénomène Kabila, avec toutes ces conséquences sociopolitiques que nous subissons jusqu’à aujourd’hui. Donc, moi, dans cet effort intellectuel, parce que c’est ça le drame dans notre pays, nous avons des acteurs politiques qui sont dans une paresse intellectuelle morbide. Moi, je suis arrivé à transcender cette situation de pauvreté intellectuelle pour comprendre l’histoire et l’anthropologie de la région des Grands Lacs.
Donc pour moi j’ai compris une chose, nous devons d’abord avoir ce Pacte Citoyen où chaque Congolais donne sa volonté pour poser les bases d’une communauté de destin. Dès lors qu’on aura maintenant ce Pacte Citoyen qui pour moi est le fondement moral pour construire une communauté de destin consciente, une nation, il faut ce fondement moral, le Pacte Citoyen, et quand on aura ce fondement moral, la deuxième étape c’est accoucher les institutions capables d’harmoniser la cohabitation des différentes composantes nationales dans le sens du bien commun. Et ça c’est le fondement intellectuel.
Donc voilà comment j’arrive à la conclusion de mon livre.
ARI – Autrement dit, les négociations qui hésitent, qui trébuchent, qui ne commencent pas, et qui doivent aller à la racine du mal congolais, est-ce que vous avez confiance que ces négociations vont aller vers quelque chose de solide pour mettre en place ce Pacte Citoyen ?
BD – Quand j’observe tout ce qui s’est fait aujourd’hui, dialogue ou je ne sais pas moi quoi, je n’y crois pas, parce que c’est comme si on veut, comme le M23 a occupé un grand espace, on va leur donner un morceau de bifteck, donc ils vont passer à la soupe, on va se partager le gâteau, tout cela, on connaît la culture congolaise, la culture politique congolaise. Non, je ne suis pas dans cette vision des choses.
L’Église, les évêques, ils ont proposé le pacte social. Avant même que les prêtres ne proposent leur pacte social, moi j’avais déjà parlé, il y avait des émissions à la télé où justement j’ai parlé de ce Pacte Citoyen. Je me dis, si les prêtres ont pris une idée venant de ma part, c’est une très bonne chose, après tout nous apportons tous notre contribution.
Donc moi j’ai commencé par le pacte social, j’ai tout fait pour que les dirigeants actuels prennent le leadership de ce Pacte Citoyen, malheureusement je ne suis pas écouté. Donc je crois qu’il faut, dans un autre cadre, arriver à trouver un leadership responsable pour poursuivre justement cet objectif de Pacte Citoyen.
ARI – Le moteur transformateur de cette situation pourrie, est-ce qu’il faut travailler avec les jeunes ? Il faut travailler avec qui ? Sur quoi va-t-il se fonder ? Par où devra-t-il commencer ?
BD – Vous savez, bien sûr, il faut transmettre les messages aux jeunes, il faut les formater, il faut qu’ils soient imprégnés de cette culture de tolérance, de démocratie et ainsi de suite, de s’accepter mutuellement pour un destin commun. Mais aujourd’hui, il y a moyen, avec toutes les forces politiques que nous pouvons avoir, qui agissent aujourd’hui, que ce soit au niveau de l’ordre politique officiel établi à Kinshasa ou à travers des groupes rebelles comme le M23, on peut, à partir des situations actuelles, on peut pousser justement et arriver à ce Pacte Citoyen. Parce que, pourquoi est-ce que les jeunes du Nord Kivu, les Banyarwanda, ont pris les armes ? Il y a une raison, et comme je vous ai dit, la cause fondamentale, c’est ça, le déni de l’identité nationale de l’autre.
Donc, avec ce Pacte Citoyen, si aujourd’hui, le M23 se donne cette vision pour mener le leadership vers ce Pacte Citoyen, pourquoi pas, on peut soutenir le M23 pour conduire cette vision de pacte citoyen.
ARI – L’espoir qui peut conduire la RDC vers le salut peut se fonder donc sur ce pacte citoyen. Et il y a l’espoir qu’avec Qatar, les négociations qui commencent à s’amorcer, le médiateur qui devra réunir les différentes parties en négociation, il faut qu’il aille dans ce sens-là.
BD – Oui, j’ai observé ces rencontres de Qatar, je ne connais pas le fond du dossier, les deux chefs d’État, celui du Congo et celui du Rwanda, je ne connais pas le contenu de leurs dialogues amorcés par le Qatar, il faut toujours encourager, mais nous avons observé l’échec de Luanda. Il y a des pays européens qui ont proposé et soutenu l’esprit du dialogue, mais voilà qu’à la veille de ce dialogue à Luanda, on a pris des sanctions contre les éléments responsables du M23. Est-ce qu’ils sont sincères dans leurs propositions ? Point d’interrogation.
Moi je ne sais pas l’esprit du dialogue de Qatar. L’Occident profiteur. Bien sûr, bien sûr. Je ne connais pas l’esprit qui imprègne, qui anime le Prince, les responsables du Qatar, mais tout est-il que s’il faut amorcer un dialogue, cela va de soi. Mais comme j’ai dit, tant que nous n’allons pas passer par ce Pacte Citoyen, le reste pour moi c’est du temps perdu.
ARI – Quelqu’un me disait que les délégués de Tshisekedi et du M23, seraient en route pour Qatar, attendons voir la suite.
BD – Oui, bien sûr, il faut encourager, mais il ne faut pas que ce soit une histoire de billets de dollars, de millions de dollars, qu’on va corrompre. Pas corrompre, mais qu’on va dire, écoutez, vous, vous déposez les armes, on vous donne tel chèque, si vous déposez les armes, vous allez entrer dans le gouvernement, on ne va pas résoudre le problème. Comme j’ai dit, tant qu’il n’y aura pas un Pacte Citoyen, et ça c’est une expérience personnelle, une expérience dans le combat politique, les recherches que j’ai faites, j’ai compris les réalités dans cette crise, pour moi il faut d’abord un Pacte Citoyen, un fondement moral, pour poser les bases d’une nation consciente dans notre pays.
