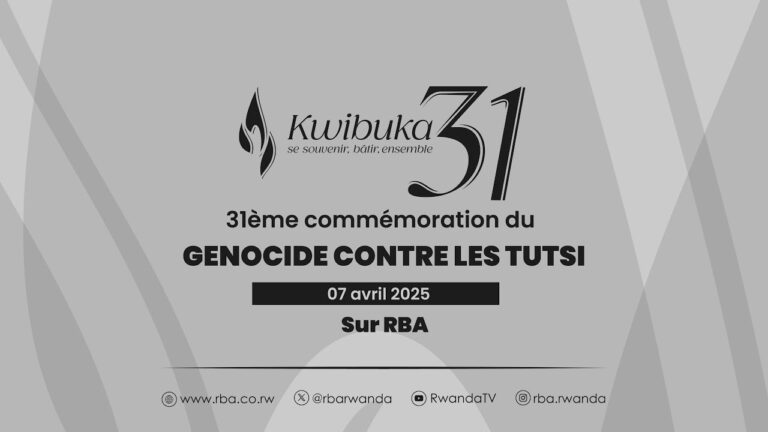
By Survie*
A l’occasion de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, le président Macron s’est félicité de « la détermination de notre pays à combattre sans relâche l’impunité et l’oubli ». S’il est vrai que la France a instauré une journée officielle de souvenir du génocide, que la justice française poursuit et condamne les génocidaires vivant en France, qu’elle a condamné pour la première fois un négationniste, force est de constater qu’envisager politiquement ou judiciairement la complicité française reste impossible. A moins que la justice administrative, maintenant saisie, ne se montre plus audacieuse ?
Voici 31 ans était lancée au Rwanda la phase paroxystique du processus génocidaire qui a conduit à la mise à mort de femmes, enfants, hommes et vieillards parce que Tutsis, près d’un million de victimes selon le gouvernement rwandais. Le long processus de déshumanisation d’une partie du peuple du Rwanda, initié sur la base de la racialisation par les colons européens d’une distinction préexistante de la société rwandaise en trois groupes sociaux distincts (Tutsis, Hutus, Twas), arrivait à son terme et plongeait les Rwandais dans l’horreur durant trois mois, sous le regard indifférent de la communauté internationale.
Depuis 31 ans, les rescapé-e-s tentent de vivre et de rendre supportable la vie dans un monde qui a laissé faire le génocide des Tutsis. Si la blessure ne guérit pas pour ces survivant-e-s, il est indispensable de chercher à comprendre le processus politique qui fut à l’œuvre, quels qu’en furent ses responsables, et comment il aurait pu être enrayé. Il est indispensable également de faire connaître et reconnaître cet épisode de notre histoire commune.
Un génocide, c’est un Etat qui mobilise ses moyens pour exterminer une population désignée comme devant mourir. Dès le lendemain de l’assassinat du président Habyarimana, le 6 avril 1994, les extrémistes hutus commettent un coup d’État et les autorités légitimes sont assassinées ou doivent s’enfuir. Un gouvernement intérimaire rwandais (GIR) est formé à Kigali, avec l’aval de l’ambassade de France. Ce gouvernement va ensuite coordonner le génocide des Tutsis.
L’État rwandais, un État criminel
En 2024, la cour d’Assises de Paris a jugé deux anciens fonctionnaires rwandais. Le premier d’entre eux, Eugène Rwamucyo, a été reconnu coupable en première instance de participation à une entente en vue de la préparation d’un génocide et complicité dans le génocide des Tutsis. En 1994, cet homme était médecin hygiéniste, et son procès a démontré qu’il avait utilisé ses compétences médicales pour organiser la disparition des corps des personnes assassinées, en vue d’effacer les preuves. Il s’est également servi de sa position de notable pour encourager la population à assassiner les Tutsis et à employer des éléments de langage qui masquaient les faits, notamment le 14 mai 1994 à Butare, au côté du premier ministre Jean Kambanda. Plus de 800 personnes s’étaient constituées partie civile dans ce procès. La cour d’assises a condamné Eugène Rwamucyo à 27 ans de réclusion criminelle.
Philippe Hategekimana – Manier fut un autre rouage de la machine génocidaire. Il était gendarme à Nyanza, une commune de la préfecture de Butare. La cour d’assises a établi qu’il avait participé à l’érection de barrières où les cartes d’identité avec mention ethnique étaient contrôlées, entraînant la mort de leurs porteurs si la mention était « Tutsi ». Ce gendarme, retrouvé en 2015 par le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR), vivait à Rennes et avait été naturalisé français en 2005. Jugé coupable de crime de génocide en première instance, il a vu sa condamnation à perpétuité confirmée en appel, plus de 30 ans après les faits.
Les procès de Rwamucyo et Hategekimana-Manier ont nécessité des efforts importants de la part d’un appareil judiciaire manquant dramatiquement de moyens depuis longtemps. Les présumés génocidaires réfugiés en France continuent à être jugés et la justice française a prononcé plusieurs condamnations qui interviennent parfois après des décennies de procédures portées en premier lieu par les rescapé-e-s, que ces procès obligent à replonger dans une mémoire toujours meurtrie pour convaincre et faire reconnaître les faits. Il est indéniable que la justice pénale fait désormais lentement son travail concernant les génocidaires vivant sur notre sol, depuis la condamnation en 2014 du premier d’entre eux, Pascal Simbikangwa. Cependant, le refus persistant de la Cour de cassation d’autoriser l’extradition vers le Rwanda de ces justiciables vieillissants leur assure bel et bien une forme d’impunité.
L’État français complice
Pourtant, dès juillet 1994, les services de l’État français avaient bien identifié les responsables du génocide et connaissaient précisément leur localisation autour de Cyangugu et Gisenyi. Le gouvernement intérimaire rwandais (GIR) était à la mi-juillet en très grande partie replié dans la zone Turquoise, protégée par les militaires français. Yannick Gérard, représentant du ministère des Affaires Etrangères auprès de Turquoise, avait recommandé à son ministère de tutelle de mettre ces criminels en résidence surveillée dans l’attente de poursuites judiciaires engagées par l’ONU. Le ministère a répondu par un message de Bernard Emié, conseiller du ministre Alain Juppé, indiquant que la présence des membres du GIR dans la zone Turquoise n’était pas souhaitée, ce qui revenait à enjoindre aux militaires de l’opération Turquoise de laisser fuir au Zaïre les responsables du gouvernement génocidaire avec tous leurs moyens militaires.
En laissant fuir les organisateurs et les concepteurs du génocide des Tutsis, les responsables français ont permis que les génocidaires puissent se réorganiser militairement et politiquement afin de reconquérir le Rwanda et de poursuivre leur projet d’extermination des Tutsis. Non contentes d’avoir permis à ces génocidaires d’échapper à la justice internationale, les autorités françaises ont maintenu leur alliance avec eux en leur fournissant nourriture, armes, entraînement militaire. À l’été 1996, un rapport de l’ONU indiquait que 50 000 hommes se préparaient à attaquer le Rwanda en le prenant en tenaille depuis le Zaïre et la Tanzanie.
L’absence de réaction de la communauté internationale face à cette menace a été une des causes de l’entrée en guerre du Rwanda au Zaïre (devenu République Démocratique du Congo – RDC) en 1996. Depuis cette date, toute la sous-région du Kivu est en proie à un conflit dans lequel des dizaines de groupes armés, certains soutenus par des Etats voisins, se livrent à une guerre dont la population congolaise subit les atrocités. La « révolution numérique » démarrée dans les années 1990 a rendu les minerais du sous-sol congolais très attractifs et leur extraction puis commercialisation permettent le financement de ce conflit sans fin dont une des racines est la fuite des génocidaires en 1994, facilitée par la France.
Première condamnation pour négationnisme
Les génocidaires en fuite n’ont eu de cesse de justifier leurs actes en diffusant un discours fallacieux qui niait le crime qu’ils avaient perpétré. Le négationnisme du génocide des Tutsis est un des outils qu’ils ont utilisés pour poursuivre leur action. Les condamnations prononcées par les cours d’assises françaises pour génocide constituent autant de démentis apportés à un discours de négation qui s’est exprimé de manière virulente dès 1994, porté et encouragé par certains responsables politiques (le ministre des Affaires Etrangères Alain Juppé, le président Mitterrand) cherchant à justifier le rôle joué par l’État français dans le soutien à ceux qui exterminaient les Tutsis. C’est en effet l’appui militaire français à partir de 1990 qui a permis aux extrémistes hutus de se focaliser sur l’organisation de la phase finale du génocide.
Il a fallu attendre 2017 pour que le négationnisme du génocide des Tutsis soit condamnable en France et patienter encore jusqu’au 9 décembre 2024 pour que la première condamnation d’un auteur négationniste, Charles Onana, soit prononcée par le tribunal judiciaire de Paris. Lors du procès, la défense de l’accusé a fait citer plusieurs militaires français qui étaient au Rwanda entre 1990 et 1994, ou qui occupaient de hautes fonctions à Paris, comme l’ancien chef de l’état-major particulier du président Mitterrand. Interrogés par la présidente du tribunal, ces officiers n’ont rien trouvé à redire aux propos tenus par Charles Onana dans son livre Rwanda, la vérité sur l’opération Turquoise. Des propos pourtant limpides, l’auteur affirmant que « [l]a thèse conspirationniste d’un régime hutu ayant planifié un “génocide” au Rwanda constitue l’une des plus grandes escroqueries du XXe siècle », ou encore que « continuer à pérorer sur un hypothétique “plan de génocide” des Hutus ou une pseudo-opération de sauvetage des Tutsis par le FPR est une escroquerie, une imposture et une falsification de l’histoire ». Ces militaires ont par ailleurs défendu à la barre la position ambiguë de la France lors de l’opération Turquoise (22 juin – 22 août 1994).
Charles Onana a été condamné pour contestation publique de l’existence d’un crime contre l’humanité, le tribunal estimant que son livre Rwanda, la vérité sur l’opération Turquoise « n’aborde la question de l’opération Turquoise que comme pur prétexte au déploiement sans frein de l’idéologie négationniste de l’auteur ». Il a fait appel, pendant que son éditeur, également condamné, faisait réimprimer l’ouvrage avant le prononcé du jugement, avec un nouveau bandeau de couverture disant : « le livre qu’ils veulent interdire ». Faire d’un procès un argument de vente… Pareille provocation devrait, en bonne logique, amener à l’avenir le ministère public à se mobiliser davantage pour empêcher la propagation de l’idéologie négationniste.
Poursuivre les complices français
La justice française a prononcé des condamnations pour génocide dans plusieurs procès mettant en cause des Rwandais, mais quand il s’agit des responsables français dont l’implication est manifeste, l’impunité reste la règle. Dans le dossier déposé par des rescapés, la LDH, la FIDH et Survie, en avril 2024, contre les responsables civils et militaires français impliqués dans l’abandon des Tutsis de Bisesero entre le 27 et le 30 juin 1994, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé, le 11 décembre 2024, l’ordonnance de non-lieu rendue par les juges d’instruction.
Cet arrêt de la cour d’appel (qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation suscite beaucoup de questions. D’abord parce que les magistrats ont confirmé le refus des juges d’instruction d’auditionner les responsables militaires et civils à Paris, considérant contre toute évidence que la décision de ne pas intervenir pour porter secours aux Tutsis de Bisesero aurait relevé exclusivement des officiers présents sur le terrain. Ensuite, parce que les juges d’appel ont renoncé à ce que la justice accède aux archives militaires alors qu’elles ont été autorisées aux historien·ne·s de la commission Duclert. Enfin parce que ce déni de justice est fondé sur une interprétation surprenante de la complicité de crime contre l’humanité, que la cour d’appel conditionne à l’intention d’aider ou d’assister l’auteur principal. Un choix à rebours des arrêts rendus par la Cour de cassation dans les affaires Papon (1997) et Lafarge (2021), où les protagonistes éponymes ont été juridiquement qualifiés de complices sans que le partage d’intention ne soit retenu.
Cette interprétation contestable est aussi celle de la commission présidée par Vincent Duclert, qui, dans les conclusions de son rapport sur le rôle de la France au Rwanda, écrit que la France n’est pas complice du génocide des Tutsis « si l’on entend par là une volonté de s’associer à l’entreprise génocidaire ». Vincent Duclert a laissé entendre depuis, à la suite de la poursuite de ses recherches, que la complicité n’était pas à exclure. Les rescapés, militants, chercheurs, journalistes, historiens, qui cherchent à connaître les mécanismes et les responsables du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994, ne peuvent que constater que la justice française sait juger les auteurs et les complices de ces actes mais que la « raison d’État » semble l’emporter aussitôt que les responsables présumés appartiennent à l’appareil d’État français.
Puisque la justice pénale ne peut pénétrer le champ de force de la complicité des responsables civils et militaires français, des rescapés et des associations les représentant ont initié en 2023 un contentieux devant la justice administrative. Cette procédure vise à faire condamner non pas tant des personnes physiques à titre personnel, que celles-ci à titre fonctionnel : elles étaient en effet partie d’un fonctionnement administratif de transmission d’informations, d’ordres, de fonds, d’armes. Ce fonctionnement a permis à l’État français de soutenir militairement, former les unités d’élite et livrer des armes à un régime qui annonçait puis qui commettait un génocide. Survie soutient cette action qui, après avoir été rejetée par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, va aller devant le Conseil d’État. Ces rejets sont motivés par une jurisprudence de 1875 du Conseil d’État qui a institutionnalisé l’absolutisme des actes du gouvernement, c’est-à-dire que les actes liés à la conduite des relations extérieures de la France ou le fonctionnement des pouvoirs publics ne sont pas susceptibles de recours devant une juridiction française.
Cette jurisprudence a au moins le mérite d’écrire de façon explicite ce que nous observons pour le génocide des Tutsis mais aussi pour tous les crimes coloniaux : les responsables de l’État n’ont pas à rendre de comptes à leurs administrés sur des décisions qui engagent l’État français y compris quand celles-ci sont liées à des crimes contre l’humanité ou crimes de génocide.
Tant que les responsables français ne seront pas jugés pour complicité, tant que le “secret-défense” couvrira leurs décisions et que la jurisprudence des “actes de gouvernement” leur assurera l’impunité, le “plus jamais ça” restera une incantation et L’État français pourra se rendre à nouveau complice de génocide et de crimes contre l’humanité.
PS : Archives
Les militants de Survie poursuivent leur travail d’investigation dans le fonds d’archives déclassifiées à la suite du rapport Duclert. Il apparaît maintenant clairement que cette modeste sélection de documents est la seule qui soit librement accessible au public si tant est qu’il se rende aux Archives Nationales de St Denis (93). En effet, les demandes faites directement auprès du Service historique des armées (SHD) sur des documents auxquels la commission Duclert n’a pas eu accès reçoivent des fins de non-recevoir diverses et variées et dont les motifs évoluent et se mélangent. Comme si les archives militaires qui concernent le Rwanda des années 1990 faisaient l’objet d’une attention spécifique de la part des services de l’État. (Fin).
*Survie est une association française créée en 1984 dont les objectifs officiels sont notamment de ramener à la raison la politique africaine de la France et combattre la banalisation du génocide.
