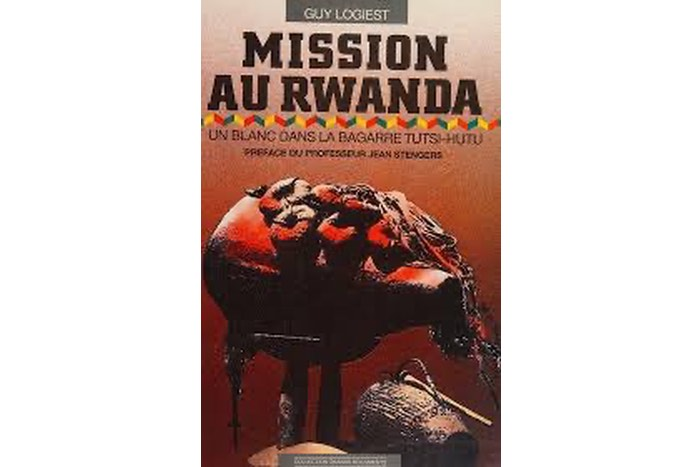
Par Alain Destexhe*
C’est avec un profond malaise – et un certain dégoût – que j’ai refermé “Mission au Rwanda : un blanc dans la bagarre Tutsi – Hutu ” (1988) de Guy Logiest. Ce colonel belge, figure centrale de la soi-disant “révolution sociale” rwandaise, y raconte sans détour son rôle dans les bouleversements politiques qui ont conduit à l’indépendance du Rwanda. Son récit illustre une vision autoritaire et unilatérale de l’action coloniale, sans doute unique dans les processus de décolonisation, dont les effets furent tragiques.
Un pouvoir quasi total entre les mains d’un seul homme
Logiest débarque au Rwanda le 5 novembre 1959. Il ne connaît rien du pays, à l’exception d’un unique ouvrage lu avant son départ : “Un Royaume hamite au centre de l’Afrique” (sic). A peine six jours après son arrivée, il est nommé résident militaire. Le 17 novembre, il prend une décision majeure : nommer systématiquement des chefs et sous-chefs hutus en remplacement des autorités traditionnelles, en grande majorité tutsies. En un seul geste, il renverse la politique d’indirect rule suivie par la Belgique depuis … 1919.
Peu après, il est promu résident civil spécial, cumulant ainsi tous les pouvoirs civils et militaires. Ce pouvoir absolu, il l’utilise pour favoriser ouvertement les Hutus, destituer les leaders tutsis, encourager les partis hutus, nommer de nouveaux bourgmestres issus presque exclusivement de la majorité hutu, et appuyer le renversement du Mwami (le roi) pour proclamer la République.
Logiest : “Mon rôle n’avait-il pas été semblable à celui d’un chirurgien, qui coupe dans l’infection sans trop se préoccuper de la cause du mal ?”
Une politique arbitraire, brutale et aveugle
Logiest agit seul, appuyé par plusieurs missionnaires et par l’évêque suisse André Perraudin, rompant avec la ligne belge sans consulter ni Bruxelles ni Jean-Paul Harroy, gouverneur général du Ruanda-Urundi basé à Usumbura. En général, selon ce qu’il prétend, les autorités belges se contentent de ratifier a posteriori ses décisions unilatérales.
Logiest : « Il fallait absolument faire quelque chose pour donner aux Hutus une raison d’espérer, même si cela signifiait un usage quelque peu forcé des pouvoirs qui m’avaient été conférés. »
« Quand je me rappelle mon état d’esprit de l’époque, je trouve qu’il était surtout fait de déception devant l’incompréhension de nos autorités politiques (…) Elle s’imaginait qu’elle pourrait imposer des formules de compromis. »
“Inyenzi” … déjà !
Mais cette politique, justifiée par une rhétorique pseudo égalitariste, se déploie sans la moindre considération pour les victimes. Aucune compassion n’est exprimée pour les Tutsis tués, dépouillés et déplacés. Les massacres ne sont pas évoqués, les huttes brûlées à peine mentionnées. Pire encore, les réfugiés tutsis en Ouganda sont présentés comme des terroristes, et – déjà – comme des “Inyenzi, des cancrelats, ces insectes répugnants qui se glissent la nuit dans les habitations et se multiplient avec une étonnante facilité.”
Ce langage préfigure la logique d’exclusion brutale des Tutsis après l’indépendance.
Déni et mépris des souffrances
À propos des déplacés internes, Logiest en parle avec une grande désinvolture :
“Plusieurs milliers de Tutsis, déclarés irrécupérables par les Hutus (sic), avaient trouvé refuge, plus ou moins contre leur gré (sic), dans le Bugesera. D’autres se sont expatriés (sic) dans les pays voisins.”
Un rapport militaire de juin 1960 signale qu’à Nyamata, les Tutsis (déplacés) “mouraient comme des mouches”. Logiest réagit en note de bas de page : “Notation erronée. Si les conditions d’hébergement à Nyamata avaient d’abord été précaires, elles étaient fort acceptables en ce moment.” !!!
Une réponse révélatrice du détachement et du cynisme de celui qui tenait alors le destin d’un peuple entre ses mains.
Hostilité envers l’ONU et aveuglement politique
Tout au long du livre, Logiest critique l’ONU, qu’il accuse d’”anticolonialisme absurde” et de “faire fausse route”. Il se vante même d’avoir trompé un observateur de cette organisation lors des élections en lui cachant qu'”un délégué des partis hutus disait aussi comment il fallait voter pour la république et pour la démocratie.”
Une telle confession, faite avec fierté, illustre non seulement son activisme, mais aussi la profonde confusion de l’auteur entre une démocratie et une simple manipulation politique.
Un homme atteint d’hubris
Mon interprétation est la suivante : ce colonel autoritaire, orgueilleux et peu cultivé, s’est retrouvé propulsé dans une position de pouvoir sans supervision, dans un costume trop grand pour lui. Dans un contexte d’isolement géopolitique et de transition, la Belgique, traumatisée par les événements du Congo, a choisi de s’en remettre à “l’homme sur place”.
Logiest était atteint d’hubris – ce terme grec désignant l’orgueil démesuré que les dieux punissent. Il agit comme s’il portait seul la mission d’”émanciper” le peuple rwandais – en fait les seuls Hutus – et de le mener “à la démocratie”. Mais cette émancipation était unilatérale, brutale et aveugle aux réalités complexes du pays, à son histoire et ses traditions. A plusieurs reprises, il reconnaît d’ailleurs, pour le déplorer, que le mwami (le roi) – qu’il fit arrêter – jouissait encore d’une certain prestige, même auprès des Hutus.
Logiest écrivant en 1988 ; “Le moment était crucial pour le Rwanda. Son peuple avait encore besoin de soutien et de protection. Mon rôle était encore déterminant (sic). Aujourd’hui, après plus de 25 ans, je m’interroge sur les motifs qui me faisaient agir avec tant de détermination. C’était sans nul doute la volonté de rendre à un peuple sa dignité. C’était peut-être tout autant le désir d’abaisser la morgue et d’exposer la duplicité d’une aristocratie (tutsie) foncièrement oppressive et injuste” qu’il désigne du terme péjoratif de “camarilla”.
Il oublie cependant de préciser que la majorité des Tutsis (environ 15 % de la population, mais jusqu’à 30% dans certaines parties du pays) vivait dans les mêmes conditions que les Hutus !
Dans ces mémoires, on est bien au-delà de la simple vision coloniale paternaliste qui était alors largement partagée en Belgique et en Europe. Nous sommes en présence d’une manipulation politique de grande ampleur, d’une construction et d’une ingénierie sociale voulue par un homme doté de tous les pouvoirs et de la force militaire pour imposer sa vision simpliste de la situation. Avec des conséquences funestes : l’émergence d’un pouvoir hutu, raciste et discriminatoire pendant 32 ans après l’indépendance qui se termine dans le génocide des Tutsis en 1994.
Une conclusion implacable
Le professeur Jean Stengers conclut ainsi la préface du livre : “Pour comprendre pourquoi il y a un Congo, il faut comprendre la psychologie de Léopold II. Pour comprendre pourquoi il y a un Rwanda hutu, il faut comprendre le colonel Logiest.”
En effet. Et ce fut pour le pire. (Fin).
* Alain Destexhe est un Sénateur honoraire et initiateur de la Commission d’enquête du Sénat belge sur le Rwanda (1997) sur le rôle de la Belgique dans le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994.
