
Philomé Robert explique son œuvre lors des Rencontres du Livre Francophone
Durant les Rencontres Internationales du Livre Francophones de Kigali du 26 au 29 Mars, l’écrivain Philomé Robert (PR) d’origine haïtienne revient sur la problématique haïtienne du retour à la vie normale, une vie de paix, de sécurité, de bonne gouvernance ? Un pays tel qu’on le voudrait, paisible. L’écrivain répond en exclusivité à André Gakwaya de l’Agence rwandaise d’Information (ARI)
PR – Je fais une réponse qui peut sembler politiquement correcte, mais qui ne l’est pas en vérité. Ce n’est pas un livre à messages. L’idée n’est pas de donner des bons ou des mauvais points à un tel ou un tel. Cependant, c’est un livre haïtien qui raconte Haïti au travers de tout ce qui sous-tend ce pays.
Qu’est-ce qui le sous-tend finalement ? Qu’est-ce qui le porte aussi ? Ce qui sous-tend ce pays, c’est cette violence absolument endémique, cette violence rageuse qui n’épargne absolument rien, qui force au départ. Des enfants qui ne trouvent aucune autre solution que de partir. Partir parce qu’ailleurs, non pas que l’herbe soit plus verte ailleurs. Là, en l’espèce, l’herbe est effectivement plus verte ailleurs parce que quand on est dehors, on ne risque pas sa peau, du moins pas autant qu’en Haïti.
L’espérance de vie dehors n’est pas de 24 heures au renouvelable, comme c’est le cas en Haïti. De ce point de vue-là, le livre raconte le désarroi de générations qui sont obligées de fuir, de partir. Mais dans le même temps, ce n’est pas un livre qui a vocation à proposer je ne sais quelle solution parce que ce n’est pas un essai, ce n’est pas un livre politique, ce n’est pas un manifeste.
Mais l’avantage du roman, c’est qu’on peut, derrière des personnages principaux ou secondaires, faire dire ou dire même ce qu’on ne peut pas dire dans un reportage. Je parle du point de vue du journaliste que je suis. Et on ne peut pas non plus renverser la table.
Dans le roman, on peut renverser la table. Dans un essai, non. À moins que ce soit un truc complètement disruptif et là, pour le coup, il faut être armé, solide, pour faire face aux polémiques.
Ce n’est pas un livre à messages. Mais dans le même temps, c’est un livre qui est pétri des contradictions du personnage et peut-être aussi de son auteur. En même temps que je n’ai pas voulu donner de message, mais le message est dans la trajectoire même de Gabriel, dans la raison qui le porte à partir, dans ses aspirations, dans ses rêves, ce après quoi il court, ce dont il rêve en fait.
Et il rêve de société où les droits humains sont universellement respectés, à commencer par la sienne société Haïti. Et de ce point de vue-là, ce n’est pas un livre militant en tant que tel, mais il en a tous les airs, il en a tous les symboles.
ARI – Alors, vous êtes Haïtien, vous connaissez les problèmes de votre pays, mais aussi vous pouvez esquisser des solutions. À votre avis, qu’est-ce qui peut sauver votre pays?
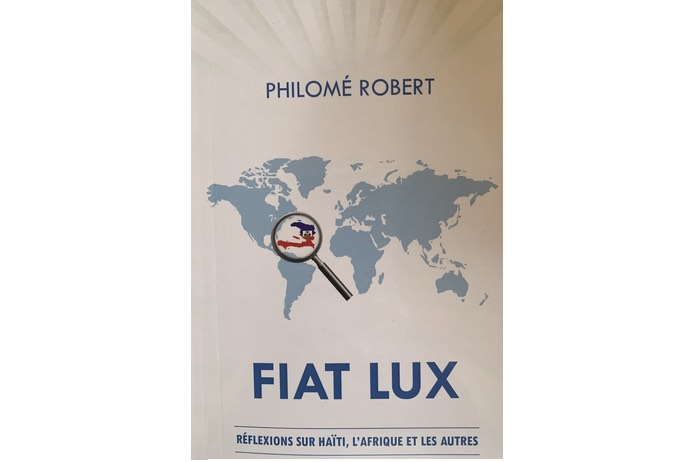
Son Livre FIAT LUX
PR – La première chose à faire aujourd’hui en Haïti, c’est de stopper, de fermer la vanne du terrorisme profondément décomplexé, choquant, qui touche la grande majorité de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce n’est pas banal, parce que Port-au-Prince, c’est un tiers des habitants du pays, pour ne pas dire plus. Haïti, c’est 12 millions d’habitants, et Port-au-Prince, c’est autour de 4 millions, 4,5 millions.
Donc, quiconque a la main sur Port-au-Prince, a quelque part la main sur la tête, le cœur, les intestins de ce pays. Le reste est périphérique, et je ne le dis pas dans une logique jacobine, je le dis en tenant compte des réalités qui sont les nôtres. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu’aujourd’hui, par exemple, des enfants, encadrés par des adultes, portent des armes contre la République et font couler le sang d’autres enfants. Ils font couler le sang d’autres citoyens de manière extrêmement massive. Eh bien, aujourd’hui, par exemple, il faut arrêter cette vanne du terrorisme, cette vanne de sang qui coule à flot. Deuxièmement, il faut un retour à la normalité constitutionnelle.
Haïti, aujourd’hui, c’est un budget de 2,8 milliards d’euros, par exemple, 2,8 milliards d’euros, quelque chose comme 3 milliards de dollars. C’est un pays qui n’a pas eu de budget, de loi de finances depuis 6 ou 7 ans, si mes souvenirs sont bons. C’est un pays avec un taux de pauvreté extrêmement élevé.
Je n’ose même pas donner les chiffres. C’est un pays où 5 millions de personnes sont en situation de famine ou de quasi-famine. Donc, il y a une extrême urgence à nourrir, déjà, cette partie de la population qui est en train de basculer, de sombrer dans la famine.
Donc, la vanne du terrorisme arrêtée. Donc, stopper cette rivière de sang qui coule. Deuxièmement, un retour à la normalité constitutionnelle pour faire en sorte à ce que, finalement, Haïti puisse se remettre dans le sens de la marche sur le plan politique.
Et pour cela, il faut plus que des accords politiques. Il faut plus que des accords d’appareils. Il faut plus que des accords entre coquins.
Parce que, ça aussi, on a l’habitude, la plupart du temps, on a des associations de malfaiteurs qui se réunissent et ça aboutit à des espèces de codes mal taillés, d’accords qu’on va s’empresser, d’ailleurs, de ne pas respecter. Alors qu’il y a une constitution, même si elle est imparfaite, mais elle est là. On va s’en tenir à une espèce de résignation. Alors, il y a une théorie, évidemment, juridique autour de ça. C’est la théorie des formalités impossibles. C’est-à-dire que, quand, par exemple, légalement, il n’y a rien à faire parce que tout a été exploré ou il n’y a rien à tenter sur le plan juridique parce que la situation ne s’y prête pas, la théorie des formalités impossibles, on a le cadre.
On ne peut pas respecter le cadre pour des raisons bêtes, pratiques et méchantes. Qu’est-ce qu’on fait ? En Haïti, on a l’habitude de fomenter des accords politiques qu’on va s’empresser de ne pas respecter. Peut-être déjà commencer par respecter les accords qu’on a signés.
Ensuite, tout faire avec un sens extrême de l’urgence pour remettre Haïti dans le sens de la normalité institutionnelle pour qu’aujourd’hui, par exemple, si la mairie de Kigali veut développer des rapports avec la mairie de Port-au-Prince pour partager un savoir-faire, une expérience en matière de gestion urbaine, en matière de propreté, de gestion des déchets, etc. Mais la mairie de Kigali, aujourd’hui, n’a pas de vis-à-vis en ce qui concerne Haïti. Si la mairie de Port-au-Prince est une mairie non élue, on a des gens, et ce n’est pas de leur faute, mais qui ne peuvent pas assumer des responsabilités parce qu’ils n’ont pas de mandat.
Donc, aujourd’hui, de toute façon, quoi qu’il arrive, il faut des élections dans ce pays. Il faut des élus qui soient représentatifs, tant soit peu, du pays pour que les interlocuteurs africains auxquels on pense, étrangers auxquels on pense, puissent avoir des vis-à-vis et pour qu’on puisse mettre en œuvre des politiques modernes, des façons modernes de faire les choses en tenant compte des pesanteurs, des lourdeurs anthropologiques, sociétales, géographiques, culturelles. C’est très important parce qu’on ne va pas sombrer non plus dans une espèce d’optimisme béat, mais au moins commencer par quelque part.
Le début, déjà, c’est arrêter la vanne de sang. Deuxièmement, remettre le pays dans le sens de la normalité institutionnelle. Et parallèlement à ça, s’occuper des 5 millions de personnes qui sont en situation de famine ou de quasi-famine aujourd’hui.

Avec d’autres écrivains dans un panel fait de Joe Sully et Christophe Dabitch
ARI – Et les armées qu’on a déployées, notamment les Kenyans, les Tunisiens…
PR – Il y a tout le monde, sauf que, je ne sais pas quelle est la question, mais j’anticipe un peu la réponse. Cette mission-là, c’est une mission de mercenaires, pour dire la chose telle qu’elle est. C’est une mission de mercenaires d’État qui sont peut-être de bonne foi, mais la mission d’abord est payée par les Américains et les Kenyans sont payés par les Américains pour faire un travail que les Américains veulent qu’ils fassent.
Les Américains sont les donneurs d’hommes dans cette affaire-là. Et d’ailleurs, on observe curieusement que depuis que cette mission est là, hormis quelques escarmouches avec les groupes terroristes et criminels, il n’y a rien, absolument rien. C’est une mission qui ressemble à une stratégie qui aurait pour mission de renverser la vapeur, de reprendre le contrôle de ce qu’une ancienne ministre appelait les territoires perdus de la République pour faire en sorte que la vanne de sang arrête de couler.
En Haïti, en 2024, c’était six mille morts, plus qu’en Ukraine d’ailleurs. Et depuis le début de cette année, on ne compte pas le nombre de morts et de déplacés, de blessés, qui se comptent par dizaines de milliers, soixante mille déplacés au bas mot. Aujourd’hui, cette mission kényane est en attente d’ordre de ces véritables donneurs d’ordre, à savoir les Etats-Unis d’Amérique du Nord.Entre-temps, il y a eu ce changement avec Mr Trump, donc on ne sait pas ce qu’il va en advenir en vérité de cette mission. (Fin)
